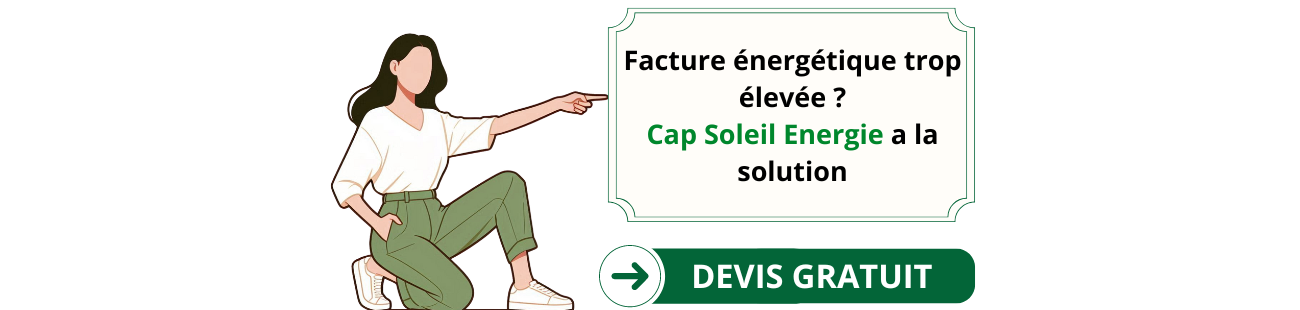Un rapport de force défavorable pour la France
Dans ce contexte, la nomination d’Agnès Pannier-Runacher comme nouvelle ministre de la Transition écologique et de l’Énergie en France est perçue par beaucoup comme une bouffée d’espoir. Son mandat précédent, entre mai 2022 et février 2024, a été marqué par des avancées notables, notamment sur le dossier nucléaire, où elle a réussi à fédérer une dizaine de pays européens autour d’une position pro-nucléaire, un exploit face à la réticence profonde de Bruxelles.
Cependant, le rapport de force s’annonce aujourd’hui moins favorable. La France, affaiblie politiquement au sein de l’Union européenne, fait face à une Commission plus idéologique que jamais, moins encline à soutenir une stratégie diversifiée intégrant le nucléaire et d’autres sources d’énergie moins intermittentes. L’atome, pourtant essentiel pour garantir une stabilité du réseau électrique tout en réduisant les émissions de carbone, semble être relégué au second plan par les institutions européennes.
Un modèle énergétique à ne pas suivre ?
Les critiques adressées à la Commission européenne sont nombreuses. Pour les détracteurs de sa politique énergétique, Bruxelles est accusée de privilégier une approche simpliste : tout miser sur l’éolien, le solaire, et les véhicules électriques, au risque de fragiliser des secteurs entiers de l’industrie européenne. Le nucléaire, l’hydroélectricité et le gaz de schiste sont écartés du débat, alors même que ces sources d’énergie pourraient offrir des solutions fiables et moins coûteuses pour assurer une transition énergétique efficace.
Ce choix de privilégier les énergies renouvelables, malgré leur caractère intermittent, oblige l’Europe à compenser en important massivement du gaz de schiste, principalement des États-Unis, ce qui accroît la dépendance énergétique du continent.
Une Europe divisée
La fracture énergétique entre les États membres s’élargit, alimentée par des divergences idéologiques et stratégiques. L’Allemagne, fer de lance de la transition énergétique européenne, voit son modèle remis en question par l’échec de l’Energiewende. Tandis que d’autres pays, dont la France, tentent de promouvoir une approche plus pragmatique et diversifiée, intégrant le nucléaire comme un pilier de la transition énergétique.
En conclusion, l’Europe semble être à un tournant décisif en matière de politique énergétique. Le défi pour Agnès Pannier-Runacher sera de défendre les intérêts français à Bruxelles tout en cherchant à réorienter une politique européenne que beaucoup considèrent sur une voie de déclin. Mais face à une Commission plus rigide que jamais, la tâche s’annonce ardue, d’autant que les choix faits aujourd’hui détermineront la souveraineté énergétique et la compétitivité de l’Europe pour les décennies à venir.