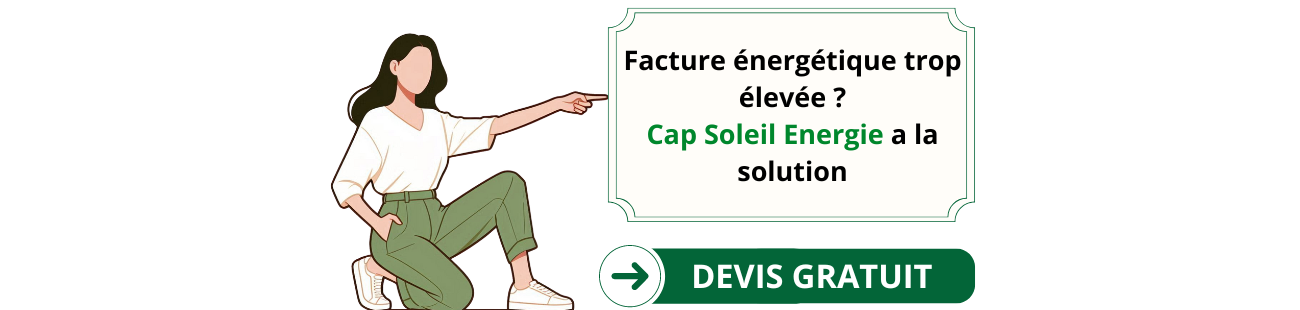Le captage de carbone : une fausse solution ?
Ce qui inquiète particulièrement les ONG, c’est la place grandissante accordée aux technologies de captage de carbone dans les stratégies de décarbonation des entreprises. Ces technologies, qui permettent de capter le CO2 avant de le stocker, sont perçues comme un pari technologique risqué. Plutôt que de réduire en amont les émissions, certaines entreprises envisageraient de recourir massivement à cette méthode pour traiter les émissions résiduelles.
Or, selon les experts, cette approche est loin d’être idéale. Elle ne s’attaque pas à la racine du problème : la réduction des émissions à la source. « Le captage de carbone ne doit être utilisé que pour les émissions impossibles à éliminer », avertissent les écologistes. En effet, de nombreuses voix dénoncent le coût prohibitif et l’incertitude quant à l’efficacité à long terme de ces technologies, tout en soulignant qu’elles risquent de détourner des fonds qui pourraient être investis dans des solutions plus durables, comme la sobriété énergétique ou l’économie circulaire.
Un financement à revoir
La décarbonation de l’industrie française ne pourra être atteinte sans un investissement massif. En 2023, l’Institut Rousseau a estimé à 48 milliards d’euros le coût de cette transition, soit 27 milliards de plus que les investissements actuellement prévus. Face à cet écart, il est recommandé que l’État prenne en charge 20 milliards d’euros sous forme de subventions, mais ces fonds devraient être orientés vers des solutions véritablement efficaces.
Le Réseau Action Climat et d’autres organisations plaident pour que ces aides publiques soient conditionnées à des objectifs sociaux, climatiques et environnementaux stricts. Elles appellent à privilégier des stratégies de sobriété et à encourager le développement de l’économie circulaire plutôt que de parier sur des technologies incertaines.
Des enjeux internationaux
Lors de la COP28, qui s’est tenue en décembre 2023 à Dubaï, le captage et le stockage du carbone ont été au cœur des discussions internationales. Si l’accord final encourage les pays à se détourner des énergies fossiles, il promeut également le développement de ces technologies controversées. Des ONG comme WWF ont alors dénoncé une vision technocentrée qui détourne l’attention des vraies solutions : la réduction drastique de la consommation d’énergie fossile et l’adoption de modes de production plus vertueux.