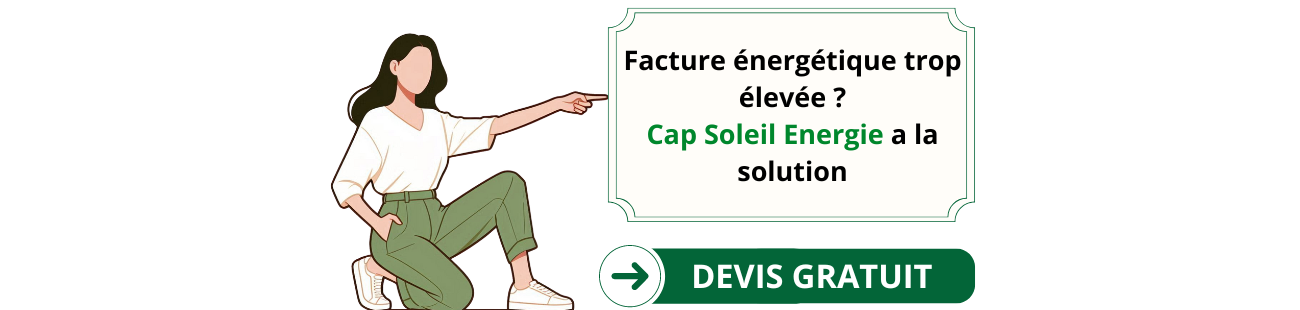Les coûts des projets en forte hausse : un frein au développement
Un autre point soulevé par le rapport est l’augmentation des coûts des installations, entre 2021 et 2023, pour la plupart des projets lauréats. Le prix des installations éoliennes terrestres a augmenté de 35 % en deux ans, atteignant 87,2 €/MWh à la fin de 2023. De même, les projets photovoltaïques au sol ont connu une hausse de 39 %, s’établissant à 81,9 €/MWh, et les projets photovoltaïques sur bâtiment ont vu leurs prix augmenter de 23 % pour atteindre 102,1 €/MWh.
Ces hausses de coûts trouvent leurs racines dans l’inflation mondiale des matières premières, le coût élevé du transport, et une pression importante sur les chaînes d’approvisionnement. En dépit de la stabilisation récente du coût des matières premières, les tarifs des projets n’ont pas pour autant amorcé de baisse, ce qui compromet la rentabilité à court terme et freine l’enthousiasme des investisseurs.
Des signes de redressement en 2023 : des perspectives meilleures
Pour autant, tout n’est pas sombre dans le paysage des énergies renouvelables françaises. Les résultats du second semestre 2023 suggèrent une tendance encourageante : une stabilisation des coûts et une meilleure structuration des appels d’offres ont permis d’insuffler un nouvel élan. La CRE reste optimiste sur la possibilité d’atteindre l’objectif global de 28 GW d’ici 2026. Cette dynamique repose sur une mobilisation accrue de tous les acteurs de la filière, ainsi que sur des améliorations dans la simplification des procédures administratives qui freinaient le développement des projets.
Vers la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie : quelles ambitions ?
L’actuelle PPE, dont le bilan reste pour l’instant mitigé, touche à sa mi-parcours. Mais tous les regards se tournent désormais vers la future programmation, dont l’annonce est très attendue. Le gouvernement devra non seulement se montrer ambitieux, mais également pragmatique pour surmonter les obstacles rencontrés au cours des trois dernières années. La transition énergétique ne saurait se contenter de demi-mesures, surtout à l’heure où la souveraineté énergétique devient un enjeu stratégique majeur.
Accélérer pour rattraper le retard : les clés du succès
Pour que la France parvienne à rattraper son retard, plusieurs leviers sont envisageables. En premier lieu, une réforme des appels d’offres pourrait être nécessaire pour les rendre plus attractifs pour les développeurs, en offrant plus de flexibilité et de soutien face aux risques financiers. Ensuite, la réduction des délais administratifs pour la mise en œuvre des projets devrait être une priorité. Enfin, l’engagement des collectivités locales et des citoyens reste un point central pour accélérer l’acceptabilité sociale des nouvelles infrastructures, qu’il s’agisse d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
Un bilan en demi-teinte mais des espoirs pour l’avenir
Le déploiement des énergies renouvelables en France est encore marqué par des retards et des obstacles, mais des signaux positifs permettent d’envisager la possibilité d’atteindre les objectifs fixés pour 2026. L’enjeu pour le gouvernement et les acteurs de la filière sera de transformer cette période de réajustement en une véritable relance de la transition énergétique, en s’assurant que les ambitions des futures PPE soient accompagnées des moyens nécessaires pour réussir.
La transition vers une énergie verte est indispensable, mais elle nécessite un engagement collectif et une volonté de s’adapter rapidement aux défis économiques, environnementaux et sociaux. C’est à cette condition que la France pourra réellement devenir un leader des énergies renouvelables en Europe.